La transition énergétique passera par la décroissance de l'ego
PHILOSOPHIE
10/23/20243 min read

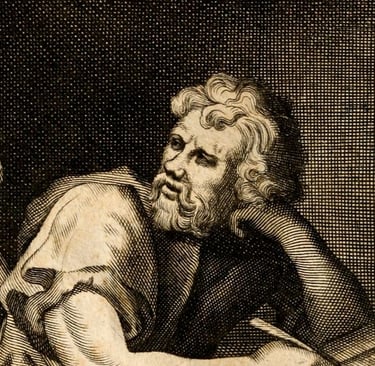
Il est possible de se soustraire à la réalité et s’envelopper ad vitam aeternam des illusions les plus affables et agréables. C’est d’ailleurs une chose dont nous avons plutôt l’habitude, et les actionnaires de Netflix, Meta, Alphabet, Sony, Microsoft et consorts ne nous en remercieraient jamais assez. Il est aussi possible de confronter cette même réalité, de mêler le blanc de ses yeux au souffle glacial qu’elle exhale, et alors il conviendra de considérer une chose : l’ensemble des crises systémiques que nous traversons trouvent leur substance dans le culte de l’ego, creuset nouveau de nos civilisations.
Ainsi ne suffit-il pas, pour celui qui souhaite mener à son terme la transition énergétique de sa nation, de subventionner les énergies vertes et de taxer les énergies fossiles. Il lui incombe aussi de sonder l’indicible abîme de la condition humaine.
Déjà dans l’entre-deux guerres, Freud (1) explore l’idée que les pulsions individualistes nourries par l’idée que l’on a de soi-même entretiennent une tension avec les besoins de la société. Aussi l’ego entre-t-il en conflit avec le bien être collectif : le vice privé ne fait donc pas le bien public. Jean Baudrillard montre par ailleurs en 1970 (2) que la consommation moderne dépasse largement la simple réponse aux besoins essentiels, et devient alors un pilier autour duquel se construit et s’affirme l’identité de l’individu. L’ego s’identifie alors à ce qu’il possède et surtout à ce qu’il acquiert, ultime prolongement du cogito cartésien : j’achète donc je suis, et je suis ce que j’achète. Aussi, je ne suis pas l’autre, lui qui n’achète pas ce que j’achète. Je suis différent. Et puisque je peux être différent, je peux aussi être supérieur. Non, je dois être supérieur.
Nous retrouvons les fondements de cette thèse au près de Guy Debord (3), qui suppose l’existence d’une aliénation consumériste où les besoins authentiques sont remplacés par des besoins artificiels, sans cesse renouvelés et réinventés par les entreprises, alors vecteurs d’un état de consommation continue et illimitée.
Ainsi peut-on sans grande difficulté supposer un solide lien de causalité entre l’émergence d’un ego complètement camé aux produits manufacturés, et la crise environnementale -celle du "toujours plus"-, qui contrarie l’ensemble de nos sociétés mondialisées. De fait, il m’est impérieusement indispensable d’acquérir tous les produits et services du rayon superlatif. Ainsi, dois-je m’enrichir -ou m'endetter-, afin de posséder le téléphone le plus récent et performant, la voiture la plus fringante et imposante, les voyages les plus en vogue et recherchés. Et si je ne le fais pas, comment pourrais-je savoir qui je suis ? Ou qui je ne suis pas ? Et tous ces besoins, d'être assidûment actualisés par l’impitoyable marché : il me faut toujours veiller et acheter de nouveau, au risque de ne plus être qui je suis, de me perdre dans le monde. Au risque de disparaître. Consommer est devenu un acte de survie existentielle.
Le cercle vicieux et impétueux de l’alliance sordide du consumérisme et de l’ego est désormais exposé au lecteur. Ainsi pouvons-nous supposer la chose suivante : que notre société carbure au charbon, au propane ou à l’hydrogène vert, la crise environnementale demeurera aussi longtemps que nous solliciterons -pour notre insatiable ego-, une croissance infinie -et effrénée-, dans un monde aux ressources finies. Aussi conviendrait-il tout à fait d’user de l’énergie avec décence, conscience et bon sens, en cessant de nourrir son petit moi avec de tristes vanités.
Nous avons dans ce papier tenté d’approcher d’une façon originale la sobriété énergétique, dont l’observance devrait permettre en 2050 la réduction de 28% des consommations d’énergie françaises par rapport à 2015 (4). Et cette réduction nous semble indispensable dans le cadre d’une transition énergétique qui consiste à délaisser un combustible fossile au pouvoir calorifique (densité énergétique) incomparable. Alors, peut-être, l’obsession du pouvoir d’achat aura-t-elle été définitivement supplantée par celle du pouvoir du moment présent, loin des élucubrations compulsives d’un ego consumériste.
(1) Freud, S. (1929). Malaise dans la civilisation. Presses Universitaires de France.
(2) Baudrillard, J. (1970). La société de consommation. Gallimard.
(3) Debord, G. (1967). La société du spectacle. Buchet-Chastel.
(4) https://www.negawatt.org/IMG/pdf/sobriete-scenario-negawatt_brochure-12pages_web.pdf
© 2025. Tous droits réservés.
